"Pour son premier long-métrage, autobiographique jusqu'au bout du filtre des milliers de cigarettes fumées, Sophie Letourneur a réalisé un énorme travail sur le son. Résultat : dans La vie au ranch, la moitié des répliques est inaudible, ne reste qu'un bruit de fond, fait de conversations, de piaillements devrait-on dire, où on essaie, tant bien que mal, de capter des phrases entières. Mais comme tout le monde parle en même temps, c'est mission impossible.
Le ranch est un appartement/poulailler où s'ébattent une petite dizaines de filles, occasionnellement accompagnées de quelques garçons. Ca picole pas mal, ça fume comme des pyromanes, ça téléphone dans tous les sens, ça se réveille à pas d'heures, bref c'est la cacophonie. Le tout semble improvisé, naturaliste et existentialiste. De quoi ça cause ? De trucs de filles de 20 ans, de mecs, principalement. Pourquoi pas, quoique à la longue, c'est lassant.
Allez, c'est le genre de film dont on a envie se débarrasser d'un revers de main. Ce serait un peu trop facile. Il y a quelque chose dans cette vie de groupe, dans ce magma destroy, qui ressemble à de l'énergie brute. La sensation aussi que de cette bouillie brouillonne va sortir quelque chose, sans savoir précisément quoi.
Les dernières scènes, auvergnates et berlinoises, confirment, une fois le calme revenu, que la réalisatrice avait un truc ou deux à dire sur le passage entre l'adolescence et la vie adulte. Rien de révolutionnaire, mais une captation singulière de l'air du temps, mise en scène de façon très personnelle, qui déroute trop pour vraiment s'attirer la sympathie.
Difficile de dire, au sortir de La vie du ranch, si Sophie Letourneur est une cinéaste à suivre. De loin peut-être, une bonne surprise de sa part, dans le futur, n'est pas à proscrire. "
Traversay Télérama



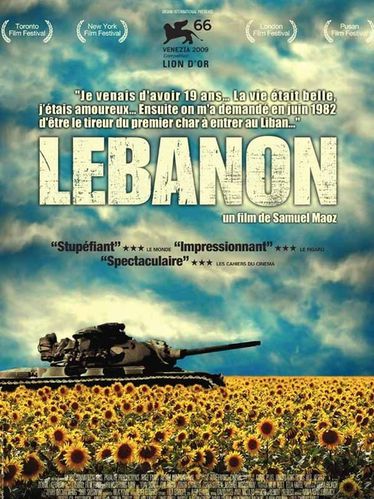
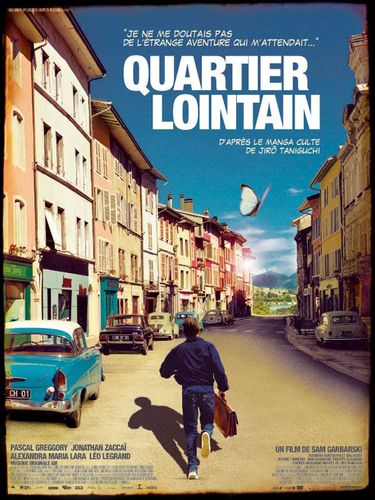 SYNOPSIS
SYNOPSIS




/idata%2F2918954%2Frouzede%2FDSC03443.JPG)
/idata%2F2918954%2Fmontgolfiere%2FP7080006.JPG)
/idata%2F2918954%2Fpaille---sons%2FP6290004.JPG)
/idata%2F2918954%2FAcqae-N-B%2Fgrains.jpg)
/idata%2F2918954%2FP-rigord-2009%2FP8130175.jpg)